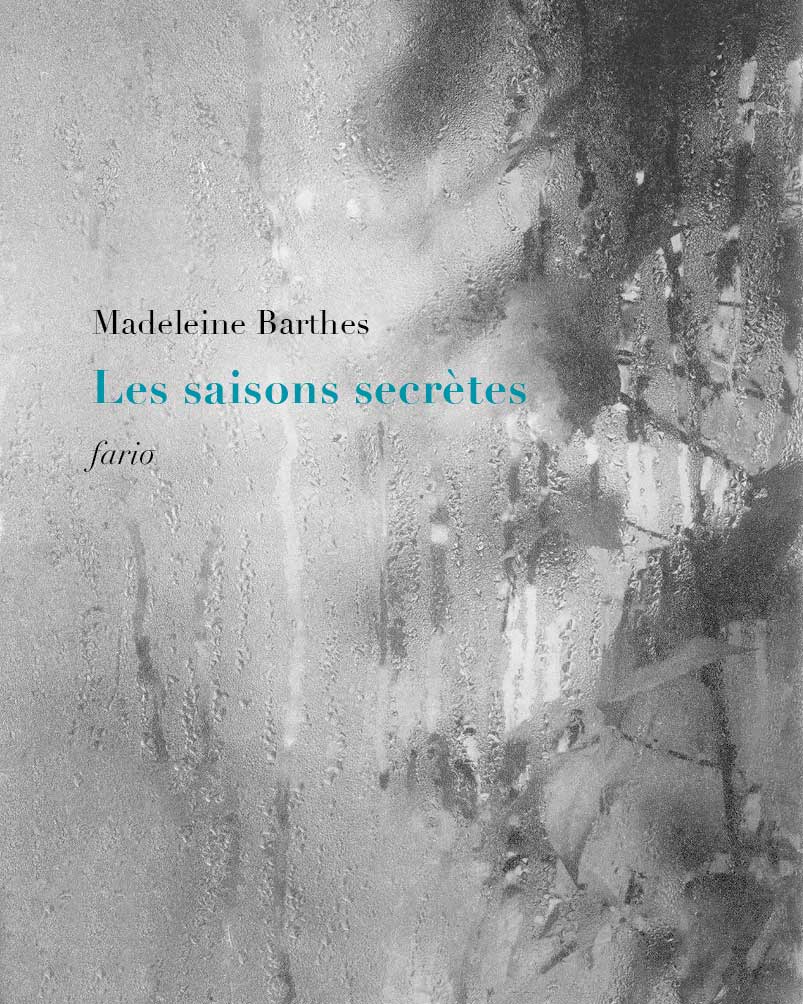Avec un prénom tellement proustien et un patronyme qui n’est pas sans rappeler telle éminente figure, Madeleine Barthes va prendre naturellement sa place dans la bibliographie du siècle dernier. Elle se rangera d’elle-même dans la catégorie des simples aux côtés d’Estelle Canzani, par exemple, parmi tous ces écrivains qui naissent sans l’être et le deviennent par hasard, parce qu’un cahot du chemin leur a mis un crayon dans les mains. Madeleine Barthes aurait du reste pu ne jamais le devenir, écrivain. Elle écrivait, voilà tout, et rien n’annonçait que la piété filiale et de solides amitiés allaient conduire une poignée de pages de ses carnets longtemps usés chez un rotativiste.
Elle était née à Toulouse en 1924 et consacra toute sa vie à la pédagogie. Fille de cheminot, elle appartient à cette génération qui eut 20 ans en 1944, connut une adolescence riche mais compliquée. Sitôt la guerre close, elle entama sa carrière de professeure. D’histoire et de français d’abord, pour les jeunes filles d’une institution nommée Le Refuge, puis dans des environnements plus exigeants comme l’École normale nationale d’apprentissage de Toulouse. Les scolarités difficiles attiraient sa vocation et son engagement, à une époque où l’émancipation par l’éducation avait du sens, où l’on savait pertinemment que la démocratie et l’individu ne se concevaient pas sans une institution pédagogique solide, dispensatrice de la manne libératrice, parmi laquelle « les poèmes égrenés dans la classe vieille / à la lumière verte des grands arbres / dans ce château désaffecté aux murs qui se lézardent / le grand bouquet de fleurs séchées / et leur odeur de paille ».
Militante syndicale et antifasciste, curieuse, lectrice conséquente, Madeleine Barthes écrivait aussi souvent, sans jamais laisser entendre qu’elle avait à dire. C’est presque par hasard, par transmission que son mari, veuf en 1977, communiqua à ses filles ses carnets que l’on est tenté de nommer « secrets ». Et pourtant rien d’obscur chez Madeleine Barthes, tout au contraire : ce sont deux carnets et quelques feuilles volantes, apparemment rédigés dans les années 1960 – 1970. Elle y posa, pour ne pas les perdre sans doute, des portraits et des dates, des moments fugaces qui persistaient à son esprit, tissant une courte biographie sentimentale et intellectuelle : » ma grand mère qui ne savait pas écrire / qui avait filé la laine sur le causse / aux yeux bleus, très clairs / qui lisait des romans d’amour / qui tirait la monnaie précautionneusement / de la poche de son tablier de satinette noire / sa petite broche en or — ses boucles d’oreilles — seul trésor. » […]
Lire la suite dans le numéro 214 du Matricule des Anges, juin 2020.