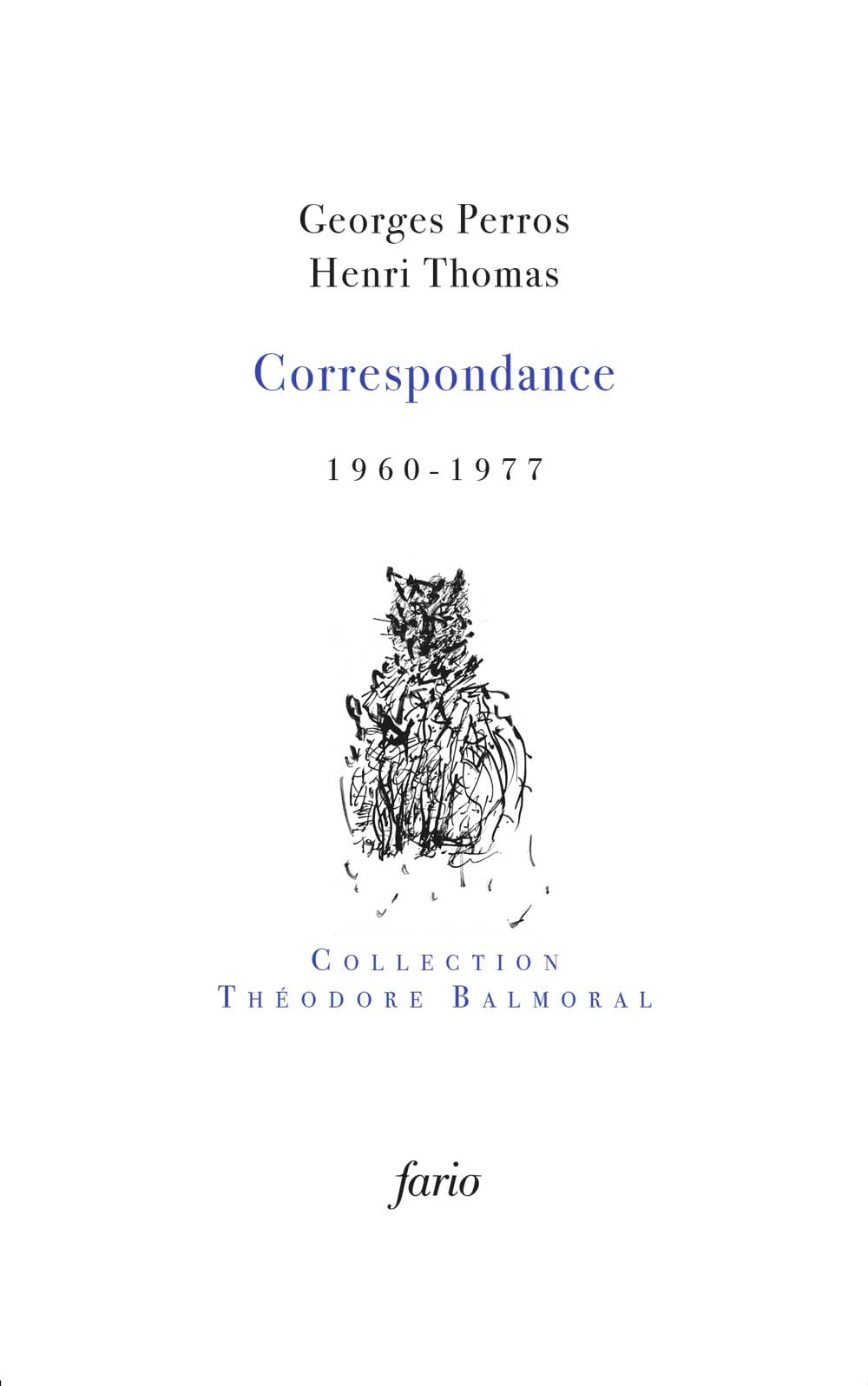Beau petit objet littéraire, raffiné, que cette correspondance. C’est Georges Perros qui l’initie, en 1960 (il a trente-six ans), en envoyant à Henri Thomas, alors aux États-Unis, ses premiers Papiers collés qui viennent de paraître. Thomas remercie, classiquement : c’est la première lettre. Lui, à quarante-huit ans, a déjà une œuvre reconnue. Perros l’admire… et le relance, pour réclamer des services de presse : 1961 est l’année de parution du Promontoire. La correspondance s’engage.
Ils se sont croisés parfois à la NRF. Thomas, sept ans auparavant, avait peu aimé une notule de Perros dans la NRF à propos de la correspondance Rilke-Gide. Or, dans les premières années de leur prise de contact, Perros lui écrit beaucoup à propos de ses livres, et de plus presque maladroitement parce que c’est autre chose qu’il cherche : lui-même si rugueux, comment s’approcher de quelqu’un qu’il sent rétractile ? L’amitié est un amour qui désire et cherche l’esprit. Et l’esprit se trouve moins facilement que le corps, et encore, si jamais ! Quant à le posséder…
Jean Roudaut écrit dans sa préface : « Thomas, distrait ; Perros, polaire. Thomas, d’esprit vagabond, oubliait de répondre ; Perros ne laissait pas une lettre sans suite, car il s’inquiétait de savoir si l’on peut être aimé autant qu’on en a le désir. Mais chacun gardait son gouffre en lui. » Une correspondance, au-delà des faits ou des propos eux-mêmes qui n’ont qu’une valeur anecdotique, ne vaut que par le rapport qui existe ou pas, qui s’établit ou pas, entre deux personnes. Tout l’intérêt ici est dans la délicatesse de la relation entre ces deux êtres. Tout un drame se joue, car le cadet est demandeur, et l’autre réticent. Quatre ans après le début de leur relation épistolaire, Perros lance l’hameçon à découvert : « Quand je vous lis [il s’agit des livres de Thomas, non de ses lettres], je regrette toujours de vous connaître si peu. Mais je me dis en même temps que c’est bien pédant de ma part ». La fin du paragraphe, désarmante de nudité, va plus avant encore, il s’y découvre davantage, et finalement il y faut beaucoup de courage : « Vous vous passez très bien de moi. À juste titre, certes ! » Et il continue par une sorte de marivaudage où la déclaration d’amour est biaisée par l’introduction d’un tiers : « Brice Parain vient tous les ans me dire qu’il vous aime bien. Voilà qui nous rapproche. On s’aime si mal dans la carrière ! Enfin bref, sachez qu’on pense à vous, et à votre œuvre, là, dans ma taule, avec… avec quoi ? Avec reconnaissance, c’est peut-être le mot. Je me sens moins seul, à vous imaginer. Et quand je vous relis, je me retrouve là où je me sens le mieux. Disons nulle part. Chez les poètes. » Cette déclaration d’amitié, comme toute déclaration, est aussi une déclaration de solitude, et le « je vous salue bien » qui termine la lettre, s’il sonne comme un recul, n’est peut-être que la peur d’avoir été impudique, le désir de ne pas être plus intrusif, de ne pas forcer un cœur. Thomas savait lire. Il savait aussi se protéger : douze ans plus tôt, il écrivait à son amie Béatrice Moulin : « j’en suis à souhaiter que personne ne m’aime ; l’amour, communément, fait trop de mal [1] ».
Le lecteur restera seul devant la déclaration de Perros : à cet endroit, il y a un trou de trois années dans la correspondance. Mais la lettre qui reprend, de Thomas, se termine par un « en vive amitié », ce qui signifie beaucoup pour un homme si distant, et d’une telle finesse d’écriture, qui prend désormais la place des formules plus attendues.
Perros signera assez vite ses lettres « Georges », mais Thomas mettra des années à quitter le « Henri Thomas » réglementaire. On attend treize ans avant que les incipit, « Cher Henri Thomas », « Cher Georges Perros », eux aussi réglementaires, deviennent « Cher Henri » et « Cher Georges », et le tutoiement ne s’installe qu’après 1975. Les lettres au fil du temps prennent un tour plus familier, un laisser-aller verbal, avec des formes parlées – « s’pas », « faut se taper », etc., venant toujours de Perros. Thomas garde son statut d’aîné, et sa plaisanterie reste masquée d’une « gravité de farceur » (le mot est de lui, à propos d’un de ses personnages, double de lui-même, dans la nouvelle « La marionnette parle »), distillée à travers les petits faits vrais, limpides et énigmatiques, qui sont sa marque, son génie d’écrivain.
Les débuts et les fins des lettres, qui évoluent de codes sociaux en signaux d’autre chose, valent la peine qu’on s’y attarde, c’est le sous-sol de l’échange. Cela dit quelque chose, le crie même, comme une intonation dans la conversation. Dans une relation d’être à être, écrite ou verbale, les mots sont peu, c’est l’espace entre eux, le non-dit, qu’on pèse, qu’on ressent. On s’y trompe rarement, c’est là qu’on cherche une réponse à la question : qu’est-ce que je suis pour lui ? Toute l’œuvre de Nathalie Sarraute prolifère dans cet espace.
Trop facile exemple, l’irruption sous la plume de Thomas, en avril 1976, des « Je t’embrasse » réitérés tout au long de l’année suivante. « Je t’embrasse », c’est à dire, étymologiquement, « je te serre dans mes bras », corps-à-corps de l’amitié, toute pudeur laissée, au moment où le corps justement fléchit et cède. Car le destin est là, en embuscade. Perros est hospitalisé à Marseille pour être traité à la bombe au cobalt. Le ton de ses lettres change. Par la force des choses, même sans qu’il s’appesantisse, on le sent accablé. Il compense cette sorte de laisser-aller, moral cette fois, par l’humour noir et l’autodérision, auxquels succèdent abruptement des « merci d’être là » et « je suis bien heureux de ton amitié ». Cette fois, c’est au tour de Thomas d’être maladroit dans sa sollicitude, empêtré de sentiments. Il craint de mettre les pieds dans le plat. Pour lui toujours dans le retrait, comment franchir la distance avec un ami dont la vie est menacée ? Puis, soudain, au retour de Perros à Douarnenez, cette phrase qui met les pieds dans le plat en effet, et qui va commencer un nouveau cycle dans la correspondance : « Il se peut que tu commences une existence qui te donnera beaucoup – et je souhaite t’aider, sans trop savoir comment – à toi de m’aider. » La lettre suivante de Perros se termine par « Affection ». Les « Je t’embrasse », de part et d’autre, suivront. Le voilà, l’abandon que Perros a si longuement cherché. Et tout au long de cette affreuse année 1977, les lettres de Thomas sont longues, nombreuses, affectueuses, avec de petits poèmes, tel celui-ci :
Tout ce que j’ai dans l’esprit
À la fin s’effacera
Je serai fait comme un rat
Et la souris
Le chat l’aura
La correspondance se termine le 31 décembre 1977 sur ces mots de Perros « Alors à bientôt ! Je t’embrasse ». Georges Perros est mort le 24 janvier 1978. Mais le livre n’est pas fini. Deux poèmes de Perros, qui font partie du fonds Doucet, servent de De profundis. Puis viennent deux postfaces de Jean Roudaut, dont la première, splendide, « Conversation avec Henri Thomas », relate ses visites à la maison de retraite de la rue Rémy-Dumoncel, dans le XIVe arrondissement de Paris, de 1991 au 3 novembre 1993, date de la mort de Thomas. Une maison de retraite ! Henri Thomas ! Mais, précisait Thomas lui-même, « où est mort Beckett » − le 17 juillet 1989, deux ans avant sa propre entrée. Compensation ? réconfort ? Thomas devait apprécier en tous cas ces petits signes en forme d’énigmes semés par le destin silencieux, (« silanxieux », aurait dit Ghérasim Luca). Dans sa « Conversation », Jean Roudaut, grinçant d’impuissante empathie comme tout un chacun confronté à cette plongée, note les progrès implacables de l’Obscur.
Encore deux textes, l’un de Thomas, datant de 1984 (Perros est mort depuis six ans), publié dans le numéro d’hommage de la revue Ubacs : « Les livres qu’il aimait, il me semble que je dois les aimer doublement, comme éclairés de son côté et du mien ». Parmi les livres aimés de Perros, il y a l’œuvre de Thomas. En miroir, un texte de Perros sur Thomas, datant de 1973 : « On se trouve devant un homme dont les meilleurs moments, et de loin, durent être de solitude […]. On le retrouve dans ses livres, débarrassé de tout interlocuteur, de tout contact humain ». La différence ? Dans un cas, l’amitié est définitivement acceptée ; dans l’autre, elle cherche encore à commencer.
Le livre a un charme fou et une grâce quelque peu dix-huitième siècle, la grâce des « Mélanges », parce que c’est un mélange, en effet, de légèreté, de distance, de tragique, de pudeur, de sensitivité. La postface de Thierry Bouchard, « Note bibliographique », stendhalienne en diable, n’y contribue pas peu.
Cf. l’excellent numéro de La Revue des Belles Lettres 2013, I, consacré à Henri Thomas.