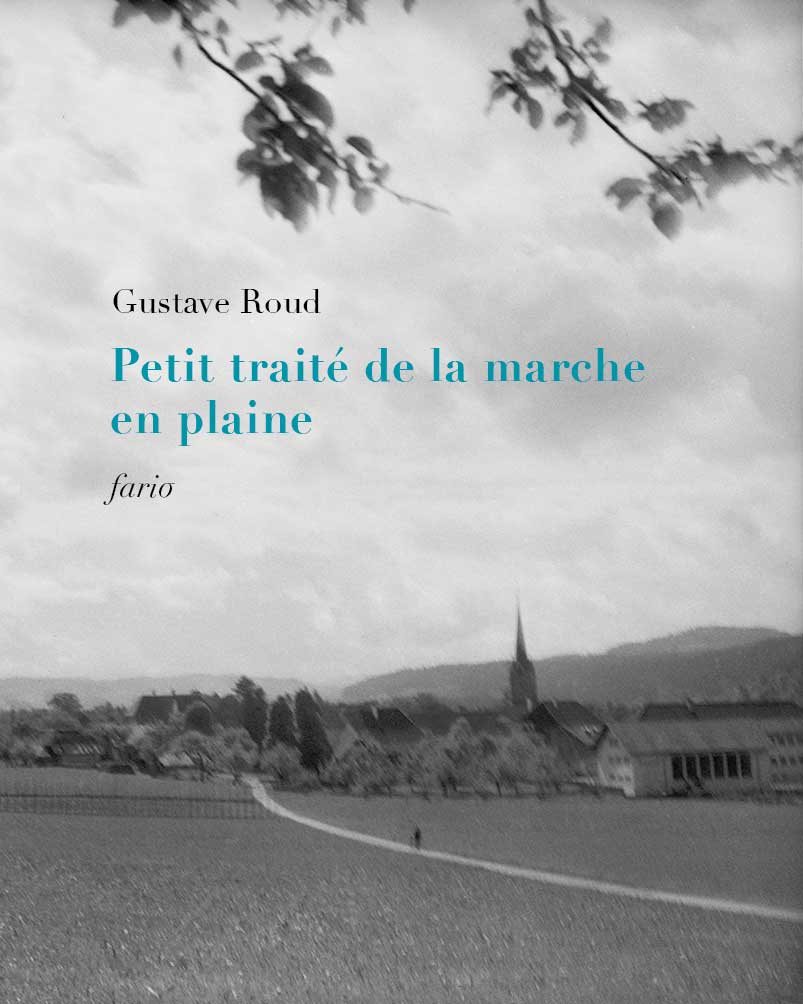Rousseau marchant « seul et à pied » donne le ton : « Je dispose en maître de la nature entière ». Comme en écho à l’exergue, Gustave Roud surplombe dès les premières pages de son Petit traité « l’espace, le temps couchés comme des chiens à nos pieds ». Plus loin, l’homme répond à son reflet : « Ce n’est pas moi qui habite l’espace, c’est l’espace qui habite en moi, et le temps lui-même, et ils dorment à mes pieds. Je suis le maître ». Mais quand le corps l’appelle, « Ombre à mes pieds, couchée parmi les feuilles ! », celle-ci l’ignore : « À tes pieds frissonnante comme un chien devant le maître qu’il ne comprend plus ». Hanté par son double, le promeneur solitaire marche seul à seul. D’où le titre de la postface de James Sacré à cette réédition des proses publiées à Lausanne en 1932 : « Solitude est peut-être un autre nom d’Aimé ». Nom du « livre ami », du « paysan dans les Écrits de Gustave Roud » ? Aimé « n’est en fait personne », aussi désincarné que les noms de villages qui n’existent plus. Où Albert Béguin voit une tentative d’acclimatation, un effort vers un « apatriement terrestre », Sacré éprouve une séparation : « Tout écrit n’est-il pas un requiem ? ».
Ici, c’est à Virgile que Roud fait écho : « Lucide cruauté » du O fortunatos qui « sépare à jamais le bonheur de la conscience que l’on en pourrait acquérir ». La conscience ne tient rien. Il faut quitter « le monde des signes » pour entrer « dans l’univers des choses », toucher enfin : « Oui, ma main va se refermer sur quelque chose, comme celle des hommes qui m’entourent ». Mais le poète restera l’étranger. Aimé, paysan virgilien, n’est qu’une ombre qui se dérobe : « Tu existes. Tu es. Tu es ce que j’aurais pu être, et tu ne le sais pas. (…) La lune se lève, tu fais sur le mur l’ombre d’un homme. Je n’en ai plus ».
Contrairement au montagnard voué aux « finasseries entre le jarret, le roc et la corde », le marcheur en plaine éprouve la proximité du ciel « qui respire, qui palpite sur sa proie et se rapproche » avec les étoiles. La proie désire le prédateur. « O ruisselle enfin, pluie suspendue ! Par pitié, que je croule en cendres sous l’averse de feu ! ». Plus loin : « Comme le moissonneur sous la pluie d’été arrache le linge de son corps, livrant sa poitrine à la grêle des gouttes énormes, que je me couche parmi les feuilles tombées, sous l’averse de votre étincellement ».
Lisez la suite sur Sitaudis.