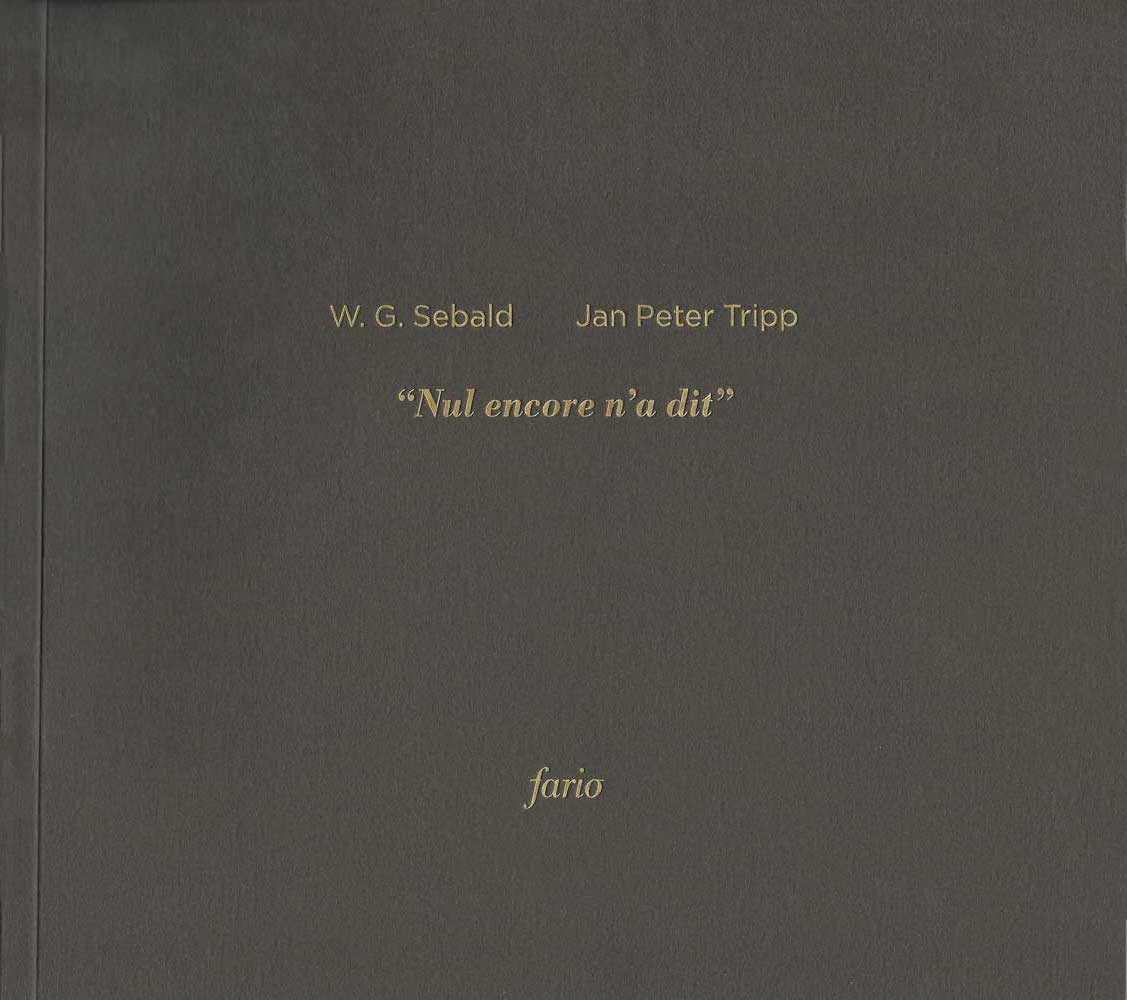Olav H. Hauge, Bateau de papier
Toulouse, Érès, collection Po&psy, 2014, édition bilingue, traduit du norvégien par Anne-Marie Soulier, photographie de Sandrine Cnudde, non paginé (56 pages), 10 euros.
W.G. Sebald, Jan Peter Tripp, Nul encore n’a dit
Paris, Fario, 2014, édition bilingue, préface de Gilles Ortlieb, traduction de l’allemand de Patrick Charbonneau, après-textes d’Andrea Köhler et de Hans Magnus Enzesberger, 92 pages, 27 euros.
Lentement émerge le vrai…
Dans un bel et sobre écrin bleu, les éditions Érès – à qui l’on doit de pouvoir lire enfin toutes les Voix d’Antonio Porchia – proposent, à travers une trentaine de poèmes couvrant trente années d’écriture, de prendre la pleine mesure de l’une des grandes figures – méconnues en France – de la poésie norvégienne : Olav Håkonson Hauge (1908 – 1994). Ce traducteur autodidacte de Bashô, Thoreau, Yeats, Whitman, Char, Bachelard, Celan, Dickinson ou Baudelaire, n’a guère quitté les fjords et les hauts-plateaux du Hardanger, où il prend soin de ses pommiers et écrit quand le lui permettent ses crises de schizophrénie. Surnommé le « jardinier d’Ulvik », le village où il a passé le plus clair de son existence, il est, comme son compatriote Tarjei Vesaas, habité par cette nature épurée et sauvage qu’il reçoit chaque jour en offrande et dont il se fait l’interprète incantatoire, le scalde panthéiste :
Je regarde un vieux miroir
D’un côté, le miroir.
De l’autre, une image du jardin d’Éden.
Drôle d’idée qu’a eue
le vieux maître verrier.
Il convient de souligner le soin apporté par les éditrices, Danièle Faugeras et Pascale Janot, à l’objet-livre : des doubles pages pliées et brochées, où la traduction française et le texte original en regard côtoient une photographie de fjords prise par l’« artiste marcheuse » Sandrine Cnudde qui, tout un mois durant, a sillonné tous les sentiers dont la demeure du poète norvégien est l’épicentre. On pénètre dans ce livre conçu pour épouser les plis synclinaux ou anticlinaux des paysages dont Haage transcrit l’indestructible fragilité, à travers l’herbe, un oiseau de passage ou une simple fleur, comme dans un paysage qui se dérobe à mesure qu’on croit s’en approcher :
La rose sauvage
On a chanté les roses,
moi je veux chanter les épines
et la racine – celle qui s’agrippe
fort à la montagne, fort comme
la main d’une jeune fille maigre.
Chambre d’écho d’un silence gorgé de vie, la poésie de Hauge est attentive aux éléments les plus insignifiants dans une nature où affleurent à vif les forces telluriques originelles. Ainsi de l’herbe verte au petit matin quand « la joie tambourine sur son bouclier de cuivre » et qui ne redoute pas « de tomber sous la faux » qui « chante en silence » tandis que « mes pensées coulent à flots ». Le « fou d’Urvik » devenu le « sage d’Urvik » fait ainsi figure de poète chinois septentrional qui scande les cycles de la nature. Olav H. Hauge est un passant autant qu’un passeur, et c’est la fuite et l’élan de l’existence humaine sertie dans la mythologie et le cosmos qu’il appréhende et délivre :
Le mot
Un mot
– une pierre
dans une rivière froide.
Encore une pierre –
il m’en faudra d’autres
si je veux traverser.
Le poème est à la fois gué et guet, posté en vigie « sur un bateau de papier » qui vogue au milieu « des étoiles / et des gouffres bleus ».
***
Durant que l’obscurité règne
Quand il meurt dans un accident de voiture, sur une route d’Angleterre, le 14 décembre 2001, W.G. Sebald laisse un manuscrit constitué de trente-trois brefs poèmes, destinés à répondre à des gravures du peintre Jan Peter Tripp pour composer un « poème des regards » où le texte et l’image « entrent en un dialogue préservant pour l’un comme pour l’autre sa propre chambre d’écho », comme l’explique Andrea Köhler. Ainsi, par une malicieuse ironie, dont Sebald lui-même aurait apprécié le sel et cherché à décrypter les signes dissimulés et les ramifications, son œuvre commence et s’achève par des poèmes. Mais si D’après nature était un long triptyque constitué autour du retable de Grünewald, ceux de Nul encore n’a dit sont des miniatures qui tiennent autant de l’épigramme que du haïku. Ce maître de la glose et de la digression, des chemins de traverse de l’exégèse s’y révèle un ciseleur concis du langage, dont l’économie du verbe épouse l’intensité des regards saisis par Tripp. Sebald, qui a toujours considéré l’image comme un fragment du récit, avait intitulé en allemand cet ensemble Unerzählt, ce qui signifie littéralement : « non raconté » :
Nul encore n’a dit
l’histoire
des visages qui
se sont détournés
Ces regards épiphaniques sont ceux de Borges, Beckett, Bacon, Rembrandt, Proust, Sebald, sa fille Anna et même son chien Maurice… Et s’ils racontent le visage tout entier, c’est comme :
La maison
dans la nuit
par les fenêtres
la lueur des
flammes
Parce qu’il n’a pas eu le temps de mener le projet jusqu’au bout et parce qu’il a échu à Jan Peter Tripp d’en réaliser l’agencement, il appartient au lecteur de trouver les résonances, les concordances faites d’accords et de désaccords entre le poème et l’image. Exercice à rebours de la pratique familière au lecteur de Sebald. Les passerelles qui s’établissent entre l’un et l’autre réunissent des territoires, parfois inconciliables, où transparaît « la doublure métaphysique de la réalité » dont parlait Sebald au sujet de l’œuvre picturale de Tripp.
Le soin particulier apporté par les éditions Fario à l’objet-livre Nul encore n’a dit, au format presque carré, en libère la charge émotive tout en préservant l’opacité voulue de ces « souvenirs-images » qui ont le regard rivé sur nous :
Je vois
des hommes car
je vois des êtres
tels des arbres
sauf qu’ils
vont et viennent
Abandonnant pour une fois l’Histoire et ses tumultes, Sebald offre ici un témoignage éclaté, kaléidoscopique d’histoires figées dans une indécision qui cristallise le rapport intime, infime entre réalité et temporalité. §
L’essentiel de l’œuvre de W.G. Sebald a été traduit aux éditions Actes Sud. La revue Europe lui consacrait un important dossier en mai 2013 (n° 1009) comprenant, entre autres, des articles de François Hartog, Jean-Christophe Bailly, Muriel Pic, ou de son traducteur Patrick Charbonneau.
Chronique parue dans le journal critique Hippocampe (N° 23, octobre/novembre 2015)