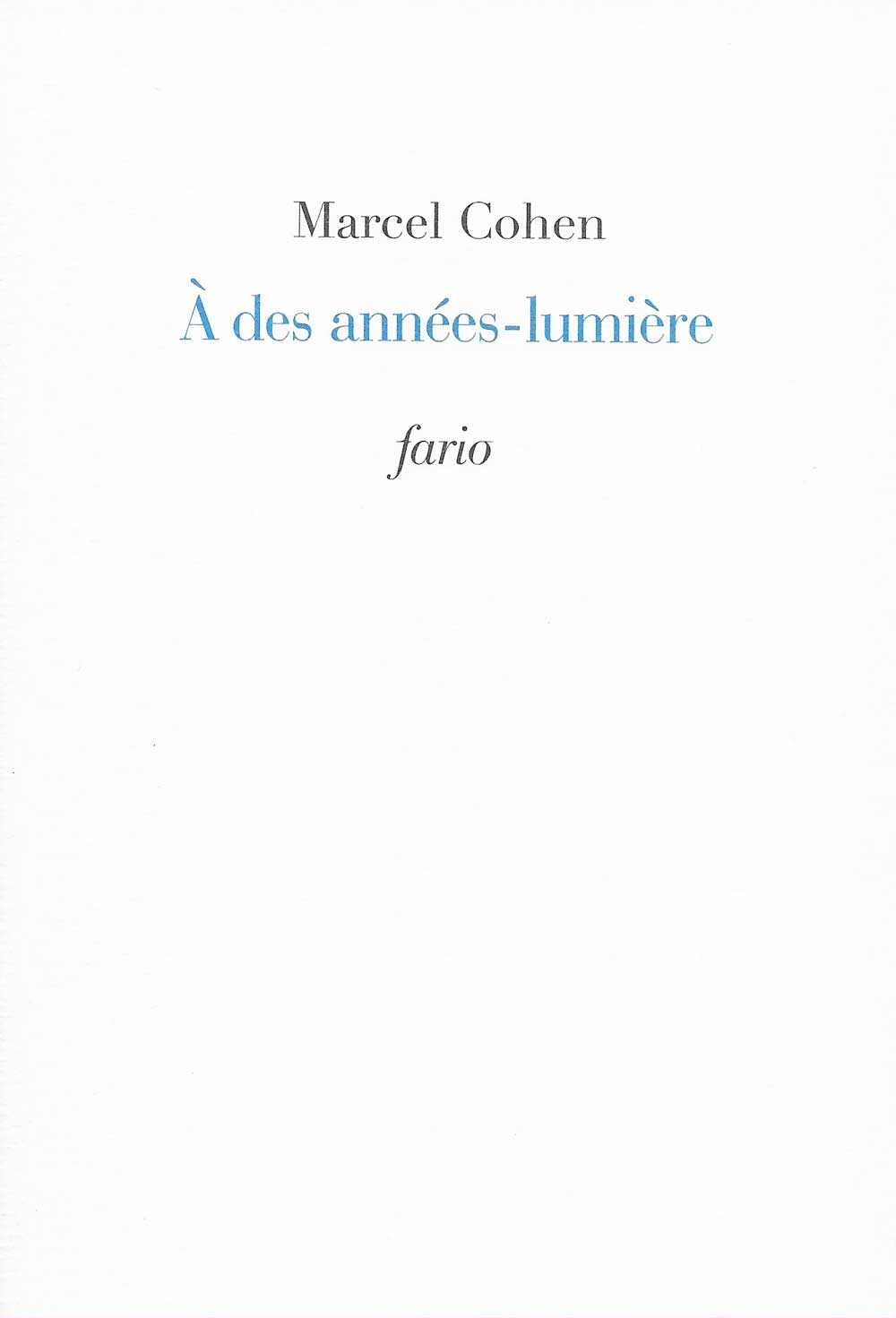Un soldat français, en opération en Centrafrique, arbore sur la manche de son uniforme un insigne nazi. Non la croix gammée mais, plus discrète, une devise en allemand : Mon honneur s’appelle fidélité, la devise des SS. La hiérarchie militaire annonce une prochaine sanction et plaide « l’inculture ». Le jeune soldat n’aurait pas su : son ignorance est son excuse. Ainsi, moins de soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la découverte des camps d’extermination, il serait aujourd’hui possible de porter des emblèmes nazis à son insu, pour la virilité des mots peut-être, de la même façon qu’il serait amusant de se déguiser en Hitler pour le bal costumé, comme on se grime indifféremment en Napoléon, César ou Attila. Cette explication par l’inculture, si elle présente l’avantage de passer sous silence l’embarrassante résurgence d’une fascination pour le régime nazi et pour son idéologie assassine, qui frappe l’ensemble des pays européens, n’en est pas moins vraisemblable. Ignorance et fascination sont les deux facettes d’un rapport corrompu à l’Histoire. Les jeunes français, nés dans la dernière décennie du XXe siècle, ne savent plus ce qu’Auschwitz signifie.
À des années-lumières, est le texte d’une conférence de Marcel Cohen, donnée en 1998 à Dunkerque et parue récemment dans une version augmentée, aux éditions Fario. Texte très court, accessible et salutaire, qui conduit le lecteur bousculé par les trépidations d’une information spectaculaire, à la réflexion sur ce qui a lieu, depuis Verdun, jusqu’aux plans de licenciements collectifs. « C’est l’humanité de l’homme qui a perdu l’essentiel de sa crédibilité », affirme Marcel Cohen au sujet des crimes contre l’humanité et des grands massacres qui ont ensanglanté le siècle dernier. L’écrivain, dont les proches ont été anéantis à Auschwitz, rappelle que « la réalité profonde du XXe siècle est d’avoir inventé l’abattage de masse », abattage industrialisé, rationalisé pour une productivité optimale. Marcel Cohen montre aussi comment l’horreur économique que nous subissons s’enracine dans cette perte, peut-être définitive, de ce qui est humain dans l’homme, perte qui a trouvé son expression absolue avec la Shoah.
« Machine de guerre » et « machinerie économique »
L’écrasement de l’homme est inhérent au système de production qui se met en place au début XXe siècle et dont la guerre constitue l’une des manifestations parmi d’autres. La guerre, observe Marcel Cohen, a connu des transformations : « Pendant la Première Guerre mondiale, un mort sur vingt était un civil », dans les derniers conflits du XXe siècle et jusque « dans l’ex-Yougoslavie, au cœur de la vieille Europe, quatre victimes sur cinq sont des non-combattants. » Et l’écrivain d’en déduire que « porter un uniforme est aujourd’hui le meilleur moyen de survivre aux conflits qui éclatent autour de nous. » Les populations civiles ne sont plus, depuis longtemps, des populations à épargner, voire à protéger, mais un matériau à utiliser. Marcel Cohen reprend ces mots de Mandelstam datant de 1923, « certaines époques disent qu’elles n’ont rien à faire de l’homme, qu’il faut l’utiliser comme des briques ou du ciment, qu’il faut construire à partir de lui et non pour lui. »
Rappelant que Primo Levi au seuil du suicide « en était venu à la conclusion qu’Auschwitz, en fait, n’avait jamais cessé », Marcel Cohen fait le rapprochement entre « ce que les Juifs ont connu pendant la guerre » et les méthode expéditives des « directeurs des ressources humaines » : « affichée le matin même dans le hall (d’une multinationale américaine), la liste d’une centaine de personnes licenciées rappelait étrangement les listes d’otages .» De même, à travers les changements opérés dans le trafic maritime des porte-conteneurs, Cohen observe que ce qui était encore évident il n’y a pas si longtemps, dérouter le navire pour tenter de sauver un homme tombé à la mer, n’est plus vrai aujourd’hui alors que les surcoûts liés aux retards de livraison de la marchandise sont évalués bien supérieurs au prix de la vie d’un marin payé 75 euros par mois pour un travail de sept jours sur sept. On voit ainsi que les migrants n’ont aucune chance d’être secourus en mer, quelque soit l’hypocrite offuscation des États qui laissent sciemment les naufragés se noyer. Dans ce système économique où sont niées les valeurs de la civilisation, « la vie humaine n’est plus rentable, il va falloir trouver autre chose », selon la terrible formule de Hubert Lucot.
Perte du moi et travail de l’écriture
Interchangeables, égaux dans leur insignifiance et leur absence de valeur, les hommes se trouvent dépossédés d’eux-mêmes. Les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, firent l’expérience de la négation de leur individualité puisque « aucune des particularités qui font qu’un homme est différent d’un autre homme n’avait plus la moindre prise sur leur vie. » On pourrait sans doute ajouter qu’avant les Juifs, les Noirs esclaves connurent une semblable confiscation de leur personnalité. Les chômeurs, aujourd’hui, ne connaissent-ils pas un traitement similaire de dés-individualisation ? Ne leur enjoint-on pas de trouver un « emploi », n’ayant plus aucun rapport avec l’ancienne notion de métier qui accordait à l’individu un savoir-faire unique, tandis qu’ils découvrent que « nul n’a plus besoin d’eux, alors même que les entreprises réalisent des bénéfices considérables » ? Et l’on peut se demander si cette insistance des pouvoirs publics à mettre en place l’individualisation des parcours, de l’élève en difficulté au « demandeur d’emploi », n’est pas le signe le plus criant de cette réfutation moderne du moi, tant il faut prendre à rebours tout ce qui est proclamé publiquement pour comprendre ce qui est fait.
Comment cette « perte de substance de l’individu, qui n’a presque plus prise sur son destin personnel », informe-t-elle le travail de l’écrivain ? S’il ne peut plus y avoir d’expérience individuelle, de sensibilité propre, dans un système où l’humain est écrasé au profit d’une machinerie économique qui fonctionne en vase clos sur des modèles erronés, alors « un écrivain a‑t-il encore quelque chose à dire ? » Marcel Cohen nous livre en guise d’apologue « ce qui s’est passé en 1995, dans Sarajevo assiégé. Un petit groupe d’écrivains serbes, croates et bosniaques, que tout aurait dû séparer, se sont réunis sur une place publique (…) pour brûler symboliquement leurs propres livres. Cet autodafé volontaire se voulait l’exact opposé des bûchers nazis de1933. » Les auteurs, désespérés par le conflit fratricide, en sont venus à brûler leur propres livres, convaincus que l’écriture n’avait rien pu empêcher du tout. C’est l’exigence éthique, l’exigence de lucidité, qui doit conduire l’écrivain dans sa recherche des formes capables de témoigner de notre temps. Mais ce travail indispensable de l’écrivain, on ne peut que se demander s’il est encore possible, tant le livre lui-même est pris sous la meule économique et ses exigences de profit.
Face à l’effritement de la mémoire collective et à la gadgetisation de l’Histoire transformée en jeu vidéo, À des années-lumières de Marcel Cohen rappelle que les événements d’aujourd’hui n’ont de sens que situés dans un contexte historique qui les transcende. Mais le jeune soldat à l’insigne nazi se trouve déjà à des années-lumière de ce vieux désir des hommes d’appréhender le passé pour mieux comprendre ce qui se joue au présent. Comment, alors, lui expliquer ?